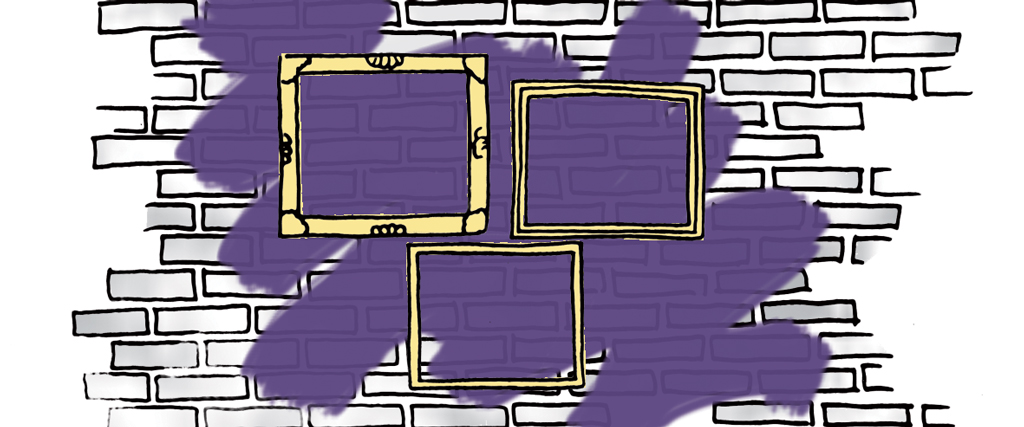CULTURE GRAFFITI à Toulouse :
la chute du mur ?
![]() [CLUTCH AUX ARCHIVES] Article publié dans Clutch#20 (juin 2014)
[CLUTCH AUX ARCHIVES] Article publié dans Clutch#20 (juin 2014)
Né dans le bouillonnement culturel de la fin des années 60 à New-York, le graffiti a connu une évolution surprenante. Si le mouvement a longtemps squatté les murs de l’underground, il côtoie volontiers ceux de l’art contemporain aujourd’hui. Comme la plupart des villes imprégnées par la culture graff, Toulouse fait face à ce cas de conscience artistique.
En novembre dernier à New-York, au cœur de Long Island, 5Pointz, considéré pour beaucoup comme la Mecque du graffiti, vivait ses dernières heures. Le propriétaire, Jerry Wolkoff, cédait aux billets verts de la gentrification galopante. Une mutation grand luxe à 400 millions de dollars et un pan entier du graffiti recouvert en quelques heures. Tout comme le Tacheles de Berlin ou la piscine Molitor de Paris (transformée récemment en baignoire à nabab), la fin de ces cimetières aux éléphants, devenus safaris touristiques, marque une rupture manifeste dans l’histoire du graffiti. Non moins à cause de leur disparition que de leur transformation en lieux de culte. Ces totems érigés en galeries street art, soumis à autorisation, étaient bien loin de l’esprit spontané et subversif du graffiti.
Par essence, le graffiti serait une pratique libertaire. Dans un billet publié par le site d’information Rue89, le pochoiriste C215 en donnait une définition romantique. « Désintéressés et volontiers anarchistes […] le but des graffeurs est de plaire à leur groupe de référence et de déplaire au corps social qu’ils entendent provoquer. S’approprier l’espace publique en réponse à l’urbanisation et la mutation de la société dont ils se sentent exclus ».
« Le street art n’est pas revendicatif mais hédoniste »
Cette forme d’expression vît aujourd’hui dans une ambiguïté alimentée par un débat sans âge : le graffiti est-il art ou vandalisme ? Une question existentielle qui a fini par ouvrir la boite de Pandore. Ersatz marketing pour les uns, reconnaissance pour les autres, le street art a rangé, qu’on le veuille ou non, la peinture de rue au rayon « commercial ». Un comble pour une pratique qui utilise les mécanismes de la publicité à des fins contraires. « Le street art n’est pas revendicatif mais hédoniste. […] Il est au graffiti ce que Doc Gynéco est aux Black Panthers » fustige l’artiste parisien.
Tilt, graffeur emblématique de la scène toulousaine, ne cache pas avoir pris le train en marche. « Je suis rentré dans un cadre contraignant. Celui des galeries, des deadlines, du business. Mais c’est un tout petit prix a payer pour vivre de cette passion ». Nombreux sont ceux qui, comme lui, se sont arrangés avec cette ambivalence. L’important, c’est l’histoire à raconter. « Je ne cherche pas à peindre dans la rue pour m’apporter une street credibility. Mais parce que j’aime ça. Sauter cette case là et se revendiquer street artist, c’est perdre toute l’histoire ».
Toulouse a longtemps été un laboratoire des cultures urbaines et particulièrement du graffiti, de la fin des années 80 au début des années 2000. Vincent, ancien graffeur de 29 ans, en a connu les derniers soubresauts. « Il y avait encore une certaine émulation à ce moment là. On allait à Job (ancienne usine de papier fermée en 2001) pour peindre le soir. On croisait Reso, Corail et des graffeurs qui venaient de toute l’Europe. Beaucoup de gens venaient voir ce qui se faisait. C’était l’attraction ».
C’était aussi la fin de la True School, crew mythique emmené par Der, Tilt, 2Pon, Ceet et Tober, qui a connu l’âge d’or du graffiti toulousain. Les spots « tolérés » étaient plus nombreux. Les fausses autorisations aussi. Le quartier d’Arnaud Bernard avait des accents new-yorkais et les fresques s’étendaient aisément le long du boulevard de Suisse et du canal latéral. « Depuis Douste-Blazy qui a fait toutes les campagnes d’effaçage, il y a beaucoup moins de spots en ville », explique le graffeur Xérou. « La municipalité ne veut pas comprendre que tolérer quelques endroits permet d’éviter la frustration et les tags. Tout effacer, c’est un non respect de notre culture ».
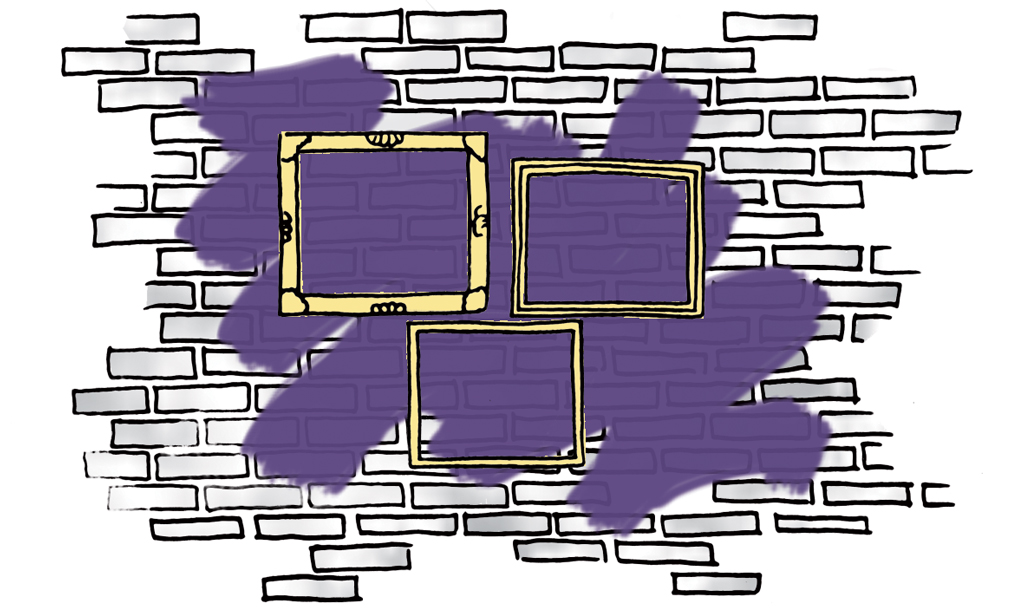
DIVISER POUR MIEUX RÉGNER ?
Hyper-médiatisé, coté et désormais tendance, l’activité « graffitique » est partout. Les événements culturels, les expositions, les commandes d’œuvres publiques ou privées s’imposent comme une nouvelle donne du catalogue street art. Depuis quelques années, certains acteurs locaux comme le Mouvement Associatif pour les Cultures Urbaines (MAPCU) ou le collectif Mémoire industrielle, sont un peu plus mis en avant par les institutionnels à travers des événements comme le Mai des Cultures Urbaines. Une manœuvre politique pour mieux contenir le mouvement ? Dans tous les cas, ce rapprochement populaire divise. « Des graffeurs comme JR ou Banksy ont développé un discours plus accessible au grand public », constate Vincent. « Aujourd’hui, les gens ne sont plus choqués. Ils distinguent ce qui est de l’art pour eux et ce qui n’en n’est pas. Mais il restera toujours des mecs qui préfèrent arracher des trains ».
« En 10 ans, le graffiti a énormément évolué », raconte Mondé, autre graffeur toulousain. « À mon époque, les marques de bombes n’existaient quasiment pas. Aujourd’hui, il y a 3 boutiques à Toulouse. C’est une sorte de reconnaissance. Mais il y a aussi les mauvais côtés. Les arrivistes, le business…». Pour Tilt, le constat est similaire. « Certaines personnes se mettent au graffiti pour de mauvaises raisons. En 25 ans, je n’en ai jamais attendu quelque chose si ce n’est des rencontres, des voyages… ».
Schizophrène ou tout simplement ancré dans la modernité, le nouveau visage du graffiti demeure polémique. Il y a deux ans, Cédric, 40 ans, graffeur toulousain mondialement connu, ainsi que 15 autres adeptes s’expliquaient devant la justice pour la dégradation des murs de Cugnaux, Toulouse et Tournefeuille. « Je ne suis pas d’accord avec le mot dégradation », retranscrivait la Dépêche du Midi. « Un graff, c’est joli. C’est une peinture. On n’a jamais rien voulu dégrader ». Vincent a également connu ces errances nocturnes entre potes. « L’adrénaline, le moment de stress juste avant d’aller peindre. J’aimais ces moments là. Mais ce qui me plaisait le plus ,c’est de me balader en ville, s’arrêter, boire un coup, peindre, fumer. C’est ça le graffiti ! ». ![]()
3 QUESTIONS À… XEROU
Comment devient-on graffeur ?
J’ai commencé il y a 17 ans. À l’époque, c’était pour moi une pratique liée au skate. Mais surtout à tout ce qu’on appelle les « cultures urbaines ». À savoir comment être créatif dans la ville. Le skate pour jouer avec le mobilier urbain et le graffiti pour faire sa pub et s’opposer à la société de consommation. Sauf que les graffeurs n’ont rien à vendre. Les gens vont s’offusquer devant un flop et passer tous les jours, sans rien dire, devant des publicités pour des steaks hachés.
Comment perçois-tu l’évolution du graffiti ?
Tous les codes du graffiti ont été avalé par la société. L’art contemporain, qui nous rejetait avant, s’intéresse à nous. À l’instar du rap ou du skate, c’est une culture qui s’est professionnalisée mais qui sert aussi de passerelle éducative auprès des jeunes.
Il y a donc un décalage entre ce qu’était le graffiti hier et aujourd’hui, non ?
C’est une pratique qui a surtout permis de désacraliser la peinture et de ramener l’art dans la rue. Les musées ne sont plus les seuls lieux artistiques. Même si cela s’est démocratisé, on verra toujours des artistes travailler en galerie le jour avant de peindre un train la nuit. Pour ma part, c’est indissociable. Il faut être en accord avec soi-même et ne pas oublier pourquoi on fait ça.
Visuel : © La Fée Clutchette